ÉTRANGERS
ÉTUDIANTS {Les)
EUROPE DE L'EST
ÉTRANGERS
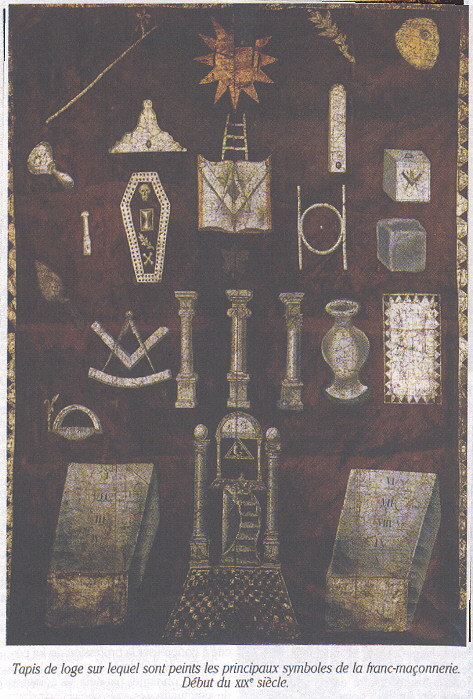 « Vous ne serez étrangers en aucun lieu; partout vous trouverez des frères et des amis; vous êtes devenus des citoyens du monde entier » déclare le secrétaire de la loge* Saint–Louis des Amis Réunis, orient de Calais, à la veille de la Révolution. Un demi siècle plus tôt, le Cévenol huguenot La Beaumelle écrivait à son frère, après son introduction dans la francmaçonnerie genevoise: « Je ne suis plus étranger !» De fait, l'accueil de l'étranger tient une place essentielle dans la réalisation du projet maçonnique des origines. Il matérialise l'utopie maçonnique donne corps à la République universelle des francs–maçons. Car l'engagement maçonnique est fondamentalement une quête d 'identité.
« Vous ne serez étrangers en aucun lieu; partout vous trouverez des frères et des amis; vous êtes devenus des citoyens du monde entier » déclare le secrétaire de la loge* Saint–Louis des Amis Réunis, orient de Calais, à la veille de la Révolution. Un demi siècle plus tôt, le Cévenol huguenot La Beaumelle écrivait à son frère, après son introduction dans la francmaçonnerie genevoise: « Je ne suis plus étranger !» De fait, l'accueil de l'étranger tient une place essentielle dans la réalisation du projet maçonnique des origines. Il matérialise l'utopie maçonnique donne corps à la République universelle des francs–maçons. Car l'engagement maçonnique est fondamentalement une quête d 'identité.
C'est au miroir de l'autre, en qui l'on reconnaît par delà ses différences, mais sans les nier, un frère, un semblable, que l'apprenti* maçon apprend à polir sa pierre* brute, à se découvrir et à trouver sa juste place parmi les ouvriers du chantier. L'étranger est donc fondamentale ment pour les frères un défi: tout forain est une menace pour l'harmonie et la concorde de la loge mais l'accueillir l'intégrer, c'est faire preuve de sa capacité à concrétiser la profession de foi cosmopolite de l'Ordre*, à projeter les valeurs maçonniques par–delà les colonnes du sanctuaire des amis choisis jusqu'aux limites du monde connu. Pour cela, il faut, à l'instar des Républicains des Lettres, mettre en place des dispositifs d'accueil des francs–maçons étrangers capables de faire face à des flux aux effectifs croissants. Les loges sont en effet confrontées au développement des voyages d'agrément et de formation, à l'implantation de communautés de réfugiés importantes (Jacobites*, huguenots, et patriotes bataves, pour ne citer que les principales, qui trouvent leurs pendants aux XIXe–XXe siècles avec les Polonais, les Russes), mais aussi de négociants issus de la Baltique, des Provinces–Unies*, ou d'lrlande*, ou aux déplacements des régiments étrangers au service des puissances européennes. Ce sont des milliers de francs–maçons plus de 3 000 en France pour 40 000 à 50 000 francs–maçons régnicoles–sujets du roi de France–pour le seul XVIIIe siècle, qu'il faut accueillir. Il s'agit là d'une des raisons d'être des loges situées dans les orients de transit. La demande de la part des élites européennes est très forte. Et de fait, l'essor d'une maçonnerie cosmopolite répond parfaitement aux exigences des élites éclairées, en terme de sociabilité : disposer, hors de la sphère publique? de réseaux laïcisés de correspondances*, d'amitié? de recommandation, que l'homme des Lumières*, en voyage d'agrément, en tour de formation, en quête de promotion sociale, de reconnaissance... puisse activer rapidement et efficacement.
Des guides de voyage mentionnent les loges que l'étranger de condition rencontrera au fur et à mesure de ses étapes. Plusieurs atlas polychromes cartographiant les implantations maçonniques ont meme été réalisés, mais la plus grande réussite tient sans doute au certificat maçonnique. Alors que l'inflation des lettres de recommandation profane en diminue considérablement le crédit, le certificat est un précieux viatique qui ouvre les portes des temples et des francs–maçons qu'il faut avoir vus ou rencontrés. Les loges peinent d'ailleurs à répondre aux étrangers qui, pressés de poursuivre leur route, demandent un certificat, ou à se faire recevoir maçon. Lorsque tel candidat, jugé trop peu motivé par l'Art royal*> est débouté, il n'est pas rare qu'il aille solliciter la loge voisine et rivale, trop contente de s'exécuter. I)'autre part l'importance des faux en circulation témoigne du succès du certificat et de l'ampleur de la demande. C'est pour se préserver de l'irruption de ces faux frères et te nombreux aventuriers, figure typique es Lumières, dans les temples que Joseph de Maistre* proposera de créer un passeport maçonnique normalisé.
La clé du succès de la sociabilité maçonnique auprès des étrangers est l'extraordinaire réseau de loges qu'elle offre: des milliers d'ateliers, supportant à leur tour des dizaines de réseaux de correspondances enchevêtrés, qui se révèlent néanmoins efficaces lorsqu'ils sont activés pour voler au secours de frères prisonniers des barbaresques, ou victimes de cataclysmes naturels. K. Pomian a insisté, dans un chapitre de L'Europe et ses nations au titre révélateur: « La deuxième unification européenne: la Cour, le salon, les loges », sur le fait que « la maçonnerie devient rapidement une institution européenne–la seule institution européenne à côté de l'Église catholique ». Si l'on remplace la correspondance manuscrite par la correspondance électronique, le commerce épistolaire traditionnel par les forums ou listes maçonniques présents sur Internet, qui voient quotidiennement tel franc–maçon européen en partance pour la Corée du Sud demander des adresses de correspondants, ou des frères brésiliens chercher des contacts en Afrique, la République universelle des francs–maçons existe toujours. Les supports médiatiques ont changé, mais l'esprit et la finalité sont les mêmes, et la conscience d'appartenir à une fraternité* universelle s'est pérennisée.
Dès le XVIIIe siècle, des ateliers se destinent clairement à l'accueil des francs–maçons. C'est ainsi qu'apparaît sur la scène maçonnique parisienne, en 1784, La Réunion des Étrangers, fruit d'une initiative franco–danoise. Munie de constitutions du Grand Orient de France*, La Réunion des Étrangers connaît un succès immédiat auprès des principaux membres de l 'ambassade de Danemark et des jeunes aristocrates scandinaves qui effectuent leur « tour de formation «. Cette loge danoise ne forme en aucune manière un cas isolé. Irlandaise du Soleil Levant (Paris) accueille les étudiants en médecine irlandais, L'Amitié (Bordeaux*), initialement dénommée L 'Amitié Allemande, est la puissante loge du commerce d'entrepôt entre les Antilles et les rives de la Baltique. Les Vrais Bataves (Dunkerque} accueillent les patriotes bataves réfugiés en France après l'écrasement de la révolution batave par l'armée prussienne à la fin de l'Ancien Régime, tandis que La Candeur (Strasbourg) initie les étudiants de l'Université luthérienne, originaires de toute l'Europe continentale. La plupart des pays européens offrent des tableaux comparables: la Grande Loge d'Angleterre compte des loges ( françaises }" tout comme les maçonneries suédoise, russe ou encore allemande... La tradition s'est maintenue jusqu'à nos jours.
Ces loges étrangères ne sont pas enkystées dans un tissu maçonnique réfractaire. Elles reçoivent fréquemment des constitutions des Grandes Loges autochtones, multiplient les visites auprès des loges locales et sollicitent de nombreuses affiliations. Elles permettent donc aux frères étrangers de se retrouver entre soi, tout en favorisant leur intégration dans la société d'accueil. En effet, ces loges sont souvent marquées par une dominante professionnelle: médicale, militaire, diplomatique, négociante ou artistique. L'occasion d'affilier des confrères du pays d'accueil ne manque donc pas. Tout un réseau de relations intra communautaires et extra communautaires se met en place, qui se révèle décisif pour une implantation réussie. L'appartenance à la loge se révèle un tremplin vers l' intégration, ou, parfois, dans le cas d'une loge autochtone largement ouverte sur les étrangers, sanctionne une insertion réussie dans un milieu professionnel et dans une ville. C'est particulièrement vrai pour les négociants étrangers qui sont admis dans les orients portuaires (Saint–Jean d' Écosse à Marseille, La Fidélité au Havre).
Quelle que soit la surface sociale des étrangers considérés, il est certain que seule une élite cosmopolite a la chance de voir s'ouvrir les portes de la fraternité sans réticence. Les obstacles linguistiques, religieux, lorsqu'on est hors de la sphère chrétienne, sociaux et financiers, dessinent le profil de l'« impossible semblable » de l'autre qui diffère trop pour être admis dans la communauté des pairs. I:)ans ces conditions, l'étranger, loin d'être une source de richesse et de diversité culturelle pour la loge, devient une menace qu'il faut circonscrire. Le cosmopolitisme des Lumières maçonniques ne se confond pas avec l'universalisme. Mutatis mutandis, il se définit plutôt comme la réunion des kaloikagathoi (« beaux et bons » de la Grèce classique, autrement dit les aristocrates), conscients par–delà les frontières politiques de former une communauté de semblables, de pairs qui ont fait leurs les normes culturelles issues du « procès de civilisation », (Norbert Elias). Les loges chics de la maçonnerie n'ont d'ailleurs pas hésité à annexer le cosmopolitisme maçonnique au royaume de la civilité et du bon goût qui s'épanouit de Spa à Naples en passant par Paris, Genève, Nice et Florence. Leurs réseaux de correspondances y font merveille tandis que leurs temples drainent les élites européennes. Mais il s'agit bien évidemment d'un cosmopolitisme mondain des habitués du Grand Tour*, des villes d'eaux et des salons. On ne saurait à bon droit le confondre avec l'universalisme du XIXe siècle, qui mobilise une frange maçonnique militante et engagée dans les grands combats du siècle.
Cette ouverture à l'étranger compromet cependant la pédagogie de l' innocence entreprise par les francs–maçons pour calmer les inquiétudes des autorités politiques, dès lors que le cosmopolitisme des Lumières, politiquement neutre, devient suspect, que la psychose du complot de l'étranger, auquel les loges pourraient apporter un support logistique, s'empare de la vie politique, comme c'est le cas en France à partir de la radicalisation révolutionnaire. Levant l'émergence du nationalisme, il n'est de salut pour certains francs maçons que dans l'allégeance absolue au régime politique en place et dans l'abandon d'une profession de foi cosmopolite devenue suspecte. Saint–Jean d'Écosse de Marseille est qualifiée de « réfractaire » par le Grand Orient de France pour avoir renoué avec sa prétendue loge mère* d'Édimbourg*. À Paris, La Réunion des Étrangers troque son titre distinctif pour celui de Marie–Louise, symbole de l'étrangère neutralisée, associée bon gré mal gré au destin de l'Empire français.
Il semble cependant que l'ouverture fraternelle à l'étranger ne soit pas morte avec l'effondrement du Premier Empire* et l'avènement de la Sainte–Alliance. En effet, on voit les loges françaises accueillir avec chaleur les francs–maçons des armées alliées d'occupation après la Restauration des Bourbons, alors que cette occupation a éprouvé, voire traumatisé. Les populations. Ces unités ont leurs propres ateliers ambulants mais leurs membres multiplient les visites aux loges civiles, ou même se portent garants des francs–maçons français auprès des nouvelles autorités locales et préfectorales. Parallèlement, l'éveil des nationalités, la participation de nombreux maçons aux combats pour l'émancipation en Amérique latine, en Europe centre–orientale. mais aussi en Espagne, au Portugal ou en Italie, provoquent parmi les francs–maçons libéraux une prise de conscience. On est ainsi impressionné par les listes imposantes de Polonais initiés au sein des loges parisiennes les plus en vue (Trinosophes*) et par la récurrence des actes de solidarité politique dans les orients portuaires (Le Havre) durant la Restauration. Le cosmopolitisme des Lumières marqué par l'accueil des étrangers dé condition, dans le respect du non–engagement politique, doit désormais laisser sa place à un universalisme plus militant matérialisé par le soutien aux francs–maçons étrangers en lutte.
P.–Y. B.
ÉTUDIANTS
(Les) (1901–1914) Cette loge* parisienne est un « atelier phare » du Grand Orient* à la Belle Époque. Elle prend naissance le 13 novembre 1901 quand douze frères forment une loge provisoire au 51, rue du Cardinal–Lemoine, dans le Ve arrondissement. Le choix est alors motivé par « la proximité du quartier habité par les étudiants de l'université et des grandes écoles ». La volonté des fondateurs est claire: installer les Enfants de la Veuve* au quartier latin.
Le 16 décembre 1901, le Conseil de l'Ordre du Grand Orient accorde la constitution à la loge, mais l'oblige à déménager au 53, boulevard Saint–Marcel, lieu où, le 21 janvier 1902, elle est solennellement installée par Desmons*, Delpech, sénateur de l'Ariège, et Masse, député de la Nièvre. Le premier maillet est tenu de 1901 à 1906 puis de 1908 à 1910 par Charles Roret (1868-1938), président de chambre et conseiller à la Cour d'appel de Paris par le Dr Danouxde 1906 à 1908, puis par l'avocat Louis Varinot, à partir de 1910.
Jusqu'en 1914, 95 % des membres étaient des étudiants ou des élèves d'une « grande école ». Bien plus sur 154 initiés ou affiliés entre 1901 et 1904, 48 sont étudiants lors de leur admission. L'atelier rassemble 32 médecins, 24 avocats 9 pharmaciens? 8 artistes, 7 directeurs d'école, 7 écrivains ou journalistes, 6 ingénieurs et 3 architectes. Ce choix « élitaire » n'empêche point l'atelier de pratiquer une certaine ouverture culturelle: on trouve aussi 10 commerçants, 6 fonctionnaireS des contributions, 5 imprimeurs, 4 assureurs, 4 entrepreneurs 3 banquiers, 2 officiers, 2 administrateurs coloniaux, 2 experts comptables et même un employé de la Compagnie du gaz, un gardien de la paix, un horloger suisses un rentier russe et le chef cuisinier qu Grand Café. Le tiers des membres des Étudiants habite le quartier latin.
Le recrutement de la loge se caractérise aussi par une forte présence étrangère. Sur 47 membres précisément connus, 15 viennent de l'Empire ottoman*, dont quelques–uns sont liés au mouvement Jeune–Turc (les anciens députés Hachim Seïd et Kemal Bey Youssof), et 11 d'Amérique latine (dont Enrique Toledo Trujillo, futur Grand Maître de la Grande Loge du Venezuela). Moins nombreux sont les Européens: ce sont des Russes (7), des Suisses (4), un Belge, un Bulgare, un Italien et un Roumain.
Durant la période, la loge va engager une vaste réflexion sur les questions sociales politiques, militaires, culturelles et morales du temps. Sur 101 conférences organisées entre 1902 et 1914, 25 sont consacrées aux problèmes sociaux, au socialisme et a l'enseignement. Les problèmes internationaux, coloniaux et militaires sont également très présents (22 exposés}. À partir de 1906, l'atelier va organiser un cycle de conférences tous les quatrièmes mardis du mois. La première série tourne autour des problèmes sanitaires, puis l'année 1907–1908 est consacrée à la rédaction « des cahiers économiques et sociaux de la démocratie du XXe siècle». La loge s'intéresser également aux questions féminines et n'hésite pas à inviter des conférencières en « tenue blanche », comme Suzanne Grunberg, Jane Misme, Blanche Pillier–Edwards ou Blanche Schweig. L'atelier organise, une ou deux fois l'an des tenues blanches « culturelles » avec exposé, concert de musique, lecture ou chant. Enfin Les Étudiants participent aux cours mixtes, publics et gratuits, aux consultations juridiques et aux conseils prophylactiques du Cercle Populaire d'Enseignement laïque (13e section), à l'École de garçons, 40, rue Jenner.
Parmi les « Étudiants » célèbres, on peut citer le journaliste Léon Archimbaud (1880-1940), futur député de la Drôme, l'avocat Paul Baudin (1878- 1928), futur vice–président du conseil général du Loirett le futur préfet Bernard Marcel, le futur ministre René Besnard (1879-1952), alors député d'lndre–et–Loire, l'auteur des paroles de La Madelon, Louis Bousquet l'avocat Gaston Brunschvig les peintres Michel de Chirikov et Giovanni Cipriani, le futur Grand Commandeur Cornelcup* Raphaël Courregelongue, futur Premier Président de la Cour d'appel de Bordeaux, le futur sénateur Paul Fleurot (1874–1946), l'avocat Joseph Lagrosillière (1872–1959), député de la Guadeloupe,
Louis Lapicque (1886-1952), futur membre de l'institut et professeur au Collège de France, Henri Laugier {1888-1973), futur secrétaire général adjoint de l'O.N.U., ou le docteur en médecine, écrivain et auteur dramatique Guillaume Wolff (1873 1932). L'atelier continuera son activité après la Grande Guerre.
Y. H.M.
EUROPE DE L'EST
(XXe siècle) La maçonnerie n'a jamais pu s'enraciner durablement en Europe de l'Est où elle a touJours été vivement combattue par divers courants religieux ou politiques, en particulier antisémites. Si elle était présente dans la plupart des pays entre les deux guerres, les obédiences* ne disposaient que d'effectifs insuffisants. Trop élitiste, cette maçonnerie ne possédait pas une base étoffée lui permettant de traverser les tourmentes. Les maçons des pays de l'Est étaient en effet des démocrates libéraux, souvent intellectuels ou grands bourgeois, attachés à la défense des droits de l'homme, parrainant des oeuvres philanthropiques. Ils subirent donc la vindicte, puis les persécutions des régimes fascistes et staliniens.
Après des années de mise en sommeil qui ont vu disparaître la génération d'avant-guerre, la maçonnerie s'est reconstituée, à partir de réfugiés politiques ou ex nihilo, à la faveur de la chute du communisme*. Plusieurs obédiences relevant des courants « libéral » ou « régulier » ont permis cette fragile reconstitution. Les difficultés sont considérables: l'antimaçonnisme* reste vivace, la tradition maçonnique ne s'est maintenue que dans quelques familles, les pays éprouvent des difficultés économiques et les maçons peuvent servir de bouc émissaire. Les nouveaux initiés souffrent d'inexpérience, ne disposent pas de locaux propres, sont souvent tributaires d'une aide extérieure. La cohabitation dans les loges* de partisans et d'adversaires des anciens gouvernements pose des problèmes. De plus, les uns sont davantage intéressés par l'ésotérisme*, d'autres par l'action politique ou sociale, d'autres enfin par les relations avec l'Occident.
La présentation d'ensemble de la vie maçonnique en Europe orientale au XXe siècle englobe les États où le fait maçonnique est l'objet d'une reconstruction formelle assez avancée, ceux où il n'en est qu'à une résurgence trés réduite, et, enfin, la Russie*.
En Hongrie*, la tradition maçonnique est ancienne et l es loges se sont reconstituées avec la naissance de la Transleithanie (18579. Le Grand Orient de France* a fondé en 1871 un Grand Orient de Hongrie qui s'est uni avec la Grande Loge Symbolique de Saint–Jean née en 1870 pour constituer la Grande Loge Symbolique de Hongrie (7 000 membres en 1914). Mais l'obédience est interdite par le régime de Bela Kun, puis par l'amiral Horthy: Les frères hongrois doivent aller maçonner à Vienne et leurs oeuvres sociales sont préservées. En 1944, les Croix Fléchées font régner la terreur et de nombreux macons sont déportés ou exécutés. Après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'en 1949, la maçonnerie, très affaiblie, peut se reconstituer; elle est même à l'origine de la Ligue hongroise des Droits de l'Homme*. Mais elle doit cesser ses travaux en 1950 et une poignée de réfugiés se regroupent en exil, notamment à Paris, au sein de la loge Martinovics (Grande Loge de France*). Sous Gorbatchev, un ancien dirigeant de la révolte étudiante de 1956, ami de la famille d'lmre Nagy, organise les premières initiations de Hongrois à Budapest. Des loges vont ensuite allumer leurs feux à partir de Martinovrcs, puis de la loge de Belfort du Grand Orient de France qui avait accueilli un réfugié social–démocrate.
Deux obédiences vont se constituer: la Grande Loge Symbolique de Hongrie réveillée à partir de Hongrois réfugiés en Autriche, et le Grand Orient de Hongrie ressuscité par le Grand Orient et la Grande Loge de France alors représentés par Jean Robert Ragache et Michel Barat. Ses convents se tiennent au Rite Écossais*, mais les loges peuvent pratiquer le Rite Français*. À leurs côtés se sont ouvertes une loge mixte du Droit Humain* (Tolerance et Fraternité, le 9 novembre 1991) et une loge féminine.
En Tchécoslovaquie, la maçonnerie est née au moment de la création du pays, en 1918. Divers groupements se sont constitués, mais deux seulement ont disposé d'une assise internationale et ont appartenu à l'A.M.I.: la Grande Loge Lessing zu den drei Ringen, de langue allemande, essentiellement implantée en terre sudète, et la Grande Loge Nationale de Tchécoslovaquie (1923) qui devait absorber le &rand Orient de Tchécoslovaquie dissident. En 1938, ces deux obédiences se mettent en sommeil et détruisent leurs archives. Un ancien maçon, le général Elias, préside le protectorat de Bohême–Moravie et évite la mise en place de la législation anti juive: malheureusement celle–ci est installée après l'exécution du général par la Gestapo La moitié des maçons tchécoslovaques auraient été tués ou déportés pendant la guerre Ceux qui avaient pu se réfugier en Angleterre organisent la loge Commenius qui, à la Libération, reconstitue la Grande Loge Tchécoslovaque Quant à la Grande Loge Lessing zu den drei Ringen, elle ne reprend pas son activité du fait de La déportation des populations allemandes des Sudètes.
Sur les 1 800 membres des deux obédiences, ils ne sont plus qu'une soixantaine à la reprise des travaux. Klecanda le premier Grand Maître, est un professeur d'université. Des relations sont nouées avec le Grand Orient de France en 1946 par l'intermédiaire du recteur de l'université de Prague. L'obédience, d'esprit socialisant, bénéficie d'un grand prestige dû à la présence en son sein du président Benès et du ministre Masaryk. La Grande Loge est installée le 26 octobre 1947, mais le Coup de Prague, en février 1948, contraint les maçons à la prudence. La police assiste aux séances du Convent* de 1949, ne se retirant que pendant les cérémonies rituelles. De nombreux maçons libéraux ou sociaux–démocrates sont emprisonnés et les loges reçoivent l'ordre de se dissoudre avant le 1er avril 1951. Le Convent prévu pour le 20 mars est retardé et ne se réunit que pour voter, à l'unanimité, la dissolution de la Grande Loge. Une campagne anti maçonnique se développe.
La maçonnerie est réveillée, ex nihilo, par le Grand Orient de France. Un jeune maçon tchèque, membre de cette obédience, en publiant dans le quotidien Mlada Fronta un article qui présente la maçonnerie libérale, est à l'origine de la création, le 12 avril 1990, de la loge Comenius 17.11.1989 (date de la chute du régime Husak). A partir d'une importante correspondance reçue au siège du Grand Orient Il va, avec l'aide d'un vieux maçon social démocrate initié dans une loge allemande? procéder aux premières enquêtes. La loge est installée par Jean–Robert Ragache, Roger Leray et André Combes. Premier Vénérable, il sera le premier Grand Maître du Grand Orient de Tchécoslovaquie qui, depuis, s'est relativement développé en province. La Grande Loge de Tchecoslovaquie a également été reconstituée par des maçons tchèques relevant de loges allemandes, et une loge mixte du Droit Humain ainsi qu'une loge féminine ont également ouvert leurs travaux en République tchèque. La maçonnerie n'en est qu'à ses débuts, à Bratislava et en Slovaquie où les traditions démocratiques sont moins ancrées.
En Pologne, c'est en 1921 qu'une Grande Loge de Pologne, à côté de loges dépendant d'obédiences allemandes, voit le jour, avec une patente de la Grande Loge d'ltalie. Avec des effectifs limités, elle est influente. Elle s'affaiblit quand elle se divise entre partisans et adversaires de Pilsudski. Attaquée par l'Église, elle est la victime de la dérive droitière du pays. Sachant que le gouvernement prépare une loi de dissolution de la maçonnerie précédée par une épuration de l'administration, la Grande Loge et les ateliers relevant du Droit Humain ou de Memphis Misraïm prononcent leur dissolution. Le décret d'interdiction est signé le 22 novembre 1938. Cette maçonnerie, liée au gouvernement en exil à Londres, ne se reconstitue pas après la guerre. Des maçons réfugiés en France fondent la loge Copernic à la Grande Loge de France qui garde des relations avec le pays.
Le Cran Orient de France va se montrer très actif après la chute de Jaruzelski. Il crée à Lille une loge de Rite Rectifié implantée dans la diaspora polonaise régionale avant d'ouvrir des loges filles en Pologne. Le Rite Écossais Rectifié*, d'inspiration christique, semblait, a priori, le mieux convenir à un pays où le catholicisme est si puissant. Parallèlement à partir d'une conférence tenue à Varsovie le &rand Orient de France procède à des initiations au Rite Français. Il en résulte l'ouverture de la loge Liberté Recouvrée, démolie en 1938 et donc réveillée, en avril 1991, à Varsovie. À la suite de divers essaimages, un Grand Orient de Pologne va obtenir une patente constitutive de l'obédience française.
La loge Copernic, qui avait rejoint la Grande Loge Nationale Française*, reconstitue, de son côté, la Grande Loge de Pologne. Le Droit Humain, suivant l'exemple du Grand Orient, allume les feux d'une loge à Lille, sous le nom distinctif de Pierre-et–Marie–Curie avant de les transférer, le 17 juillet 1993, à Varsovic. Elle bénéficie de la présence des deux derniers maçons survivants d'avant la querre. L'obédience s'est ensuite implantée à Katovice.
En Bulgarie, la Grande Loge Symbolique fondée le 27 novembre 1917, d'inspiration libérale, vit en bonnes relations avec la monarchie et le clergé orthodoxe jusqu'à l'occupation nazie en 1941. Elle ne se reconstitue pas à la Libération du fait de l'hostilité de Dimitrov. Des loges ont été ouvertes par le Grand Orient de France et Le Droit Humain. La seule obédience indépendante est une Grande Loge, de filiation anglaise.
En Yougoslavie, les premiers membres de la Grande Loge Yougoslavia, fondée après la Première Guerre mondiale par des groupuscules clandestins serbes et croates, sont des démocrates, souvent initiés en France, au Grand Orient ou à la Grande Loge, qui aspirent au rapprochement entre les communautés. L'obédience organise, à Belgrade, sous l'égide de l'A.M.I., en 1926, une conférence pour la paix et la défense de la S.D.N.*, mais les maçons se trouvent grossièrement accusés de l'assassinat du roi Alexandre. L'obédience est liquidée avec l'invasion nazie et ses membres subissent des persécutions, en particulier des Oustachis d'Ante Pavelitch. Beaucoup de maçons serbes étaient favorables à un retour de la monarchie et hostiles au communisme. Aussi, en dépit des démarches du radical Tomitch, les loges ne vont pas renaître en 1945. Aujourd'hui, la maçonnerie a refait timidement son apparition en Serbie. Une Grande Loge « régulière » de type allemand a été constituée, au moins sur le papier, et une autre loge relève des deux obédiences libérales françaises. La situation politique ne permet pas la reconstitution d'une maçonnerie yougoslave de tradition humaniste.
En Roumanie également, la tradition maçonnique est ancienne. Ce sont des maçons roumains, initiés en France, qui ont conduit la Révolution de 1848. Pourtant, si les loges ont proliféré au XIXe et au XXe siècle, elles ont toujours été divisées en obédiences rivales ou rattachées à des obédiences étrangères. La poussée fasciste (la Garde de Fer) et l'hostilité du clergé orthodoxe ont conduit le roi à dissoudre les loges en 1937. De nombreux maçons sont, pendant la guerre, exécutés par les fascistes. Les survivants reprennent leur activité, en décembre 1944, dans un pays libéré par l'Armée rouge. La maçonnerie se développe rapidement dans les milieux progressistes, mais la stalinisation du pays lui est fatale La Grande loge Nationale est fermée en 1948 et, en 1950, une effroyable répression s'abat sur ses membres. Des frères exilés ouvriront des ateliers à la Grande Loge de France. Quelques mois après la chute de Ceaucescu, le Grand Orient de France allume, dans un modeste appartement, les feux d'une première loge à Bucarest, sous le titre distinctif d'Humunitas. Depuis, des loges se sont créées en province. La maçonnerie roumaine reste fragile.
Le Grand Orient a créé une première loge clandestine en Russie en 1905. D'autres suivent, ainsi que des ateliers martinistes*, mais elles restent « sauvages » jusqu'en février 1917. Elles sont fermées après la Révolution bolchevique et la maçonnerie russe se développera en exil, en particulier en France, avec la naissance de plusieurs ateliers « spiritualistes » sous la coupe de la Grande Loge, et deux, plus laïques, du Grand Orient. Toutes les tendances de l'opposition, des monarchistes libéraux aux kérenskistes y sont représentées. Cette génération disparaît et la maçonnerie va se reconstituer ex nihilo. Le Grand Orient parti en éclaireur réveille, le 28 avril 1991 la loge L'Étoile Polaire. La cérémonie se déroule dans un rendez vous de chasse, près de Moscou, selon un rituel traduit en russe par un des participants. Ultérieurement, La Russie Libre, autre loge de réfugiés à Paris, reprend « force et vigueur ». Aujourd'hui, des loges des trois grandes obédiences françaises sont en activité en Russie et une fragile Grande Loge a été ouverte par la Grande Loge Nationale Française. Son Grand Maître, un professeur de philosophie, avait, ainsi qu'un peintre d'icônes, été initié rue Cadet. Des loges d'importance très modeste ont ensuite allumé leurs feux, notamment à Saint–Pétersbourg. En Ukraine (où une éphémère Grande Loge avait vu le jour dans l'entourage de Petlioura vers 1920) et dans les pays Baltes, la maçonnerie s'est également reconstituée, mais les pionniers ne sont qu'une poignée.
La situation de la maçonnerie en Europe de l'Est reste donc très mouvante. Elle est combattue en Pologne par une fraction de l'Église catholique et toute l'extrême droite. En Russie, inexistante, elle est déjà accusée d'être responsable des malheurs du pays et l'antimaçonnisme s'y développe de pair avec l'antisémitisme . El le n'a pas été gangrenée par l'affairisme. Les adhérents, qui relèvent du &rand Orient, sont surtout des intellectuels ou des artistes et non des hommes d'affaires. Son avenir immédiat demeure incertain car dépendant de la réussite des expériences démocratiques.
A. C.