ENCYCLOPÉDIE DE LA FRANC-MAÇONNERIE
01 type_Document_Title_here
BARTHOLDl
BASSON
BATTERIE
BAYLOT
BEAUHARNAIS
BEDARRIDES
BEGEMANN
BELGlQUE
BELLO
BÉDÉDICTINS
BARTHOLDl,
BARTHOLDI
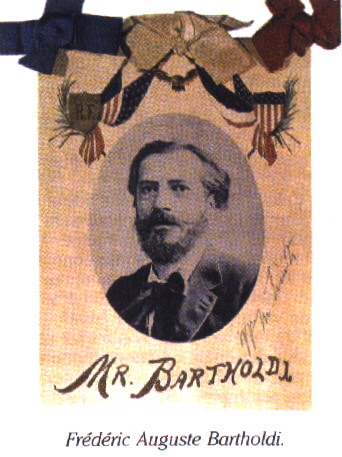 Frederic Auguste (Colmar, 1834-Paris, 1904) Bartholdi est né dans une famille protestante, dont la présence est attestée en Allemagne et en Alsace d es le XVIIe siècle e. Son père , Jean Charles Bartholdi, conseiller de préfecture, étant décédé en 1836, sa mère, née Charlotte Beysser, vient s'installer à Paris avec Auguste et son frère aîné Charles. Auguste Bartholdi fait ses études au lycée Louis-le Grand, qu'il abandonne souvent pour les ateliers d'Etex, de Soitoux, d'Ary Scheffer. Un récit veut qu'il ait été témoin de l'insurrection contre le coup d'état du 2 décembre 1851 et qu'il ait assisté au spectacle d'une jeune fille tenant une torche à la main et poussant les hommes au combat avant de s'écrouler sous les balles. Cette image lui aurait inspiré son oeuvre la plus célèbre, la statue de la Liberté, dont l'idée première incomberait à Edouard Laboulaye. Il expose pour la première fois au Salon de 1853 ou il présente un groupe intitule Un bon Samaritain. En 1856, il voyage en Égypte. Garde national, il laisse de nombreux croquis de la guerre franco-prussienne, durant laquelle il séjourne à Tours et à Bordeaux; comme tous les Alsaciens, il est éprouvé parla défaite et la cession de l'Alsace. Il effectue son premier voyage aux États-Unis en 1871.
Frederic Auguste (Colmar, 1834-Paris, 1904) Bartholdi est né dans une famille protestante, dont la présence est attestée en Allemagne et en Alsace d es le XVIIe siècle e. Son père , Jean Charles Bartholdi, conseiller de préfecture, étant décédé en 1836, sa mère, née Charlotte Beysser, vient s'installer à Paris avec Auguste et son frère aîné Charles. Auguste Bartholdi fait ses études au lycée Louis-le Grand, qu'il abandonne souvent pour les ateliers d'Etex, de Soitoux, d'Ary Scheffer. Un récit veut qu'il ait été témoin de l'insurrection contre le coup d'état du 2 décembre 1851 et qu'il ait assisté au spectacle d'une jeune fille tenant une torche à la main et poussant les hommes au combat avant de s'écrouler sous les balles. Cette image lui aurait inspiré son oeuvre la plus célèbre, la statue de la Liberté, dont l'idée première incomberait à Edouard Laboulaye. Il expose pour la première fois au Salon de 1853 ou il présente un groupe intitule Un bon Samaritain. En 1856, il voyage en Égypte. Garde national, il laisse de nombreux croquis de la guerre franco-prussienne, durant laquelle il séjourne à Tours et à Bordeaux; comme tous les Alsaciens, il est éprouvé parla défaite et la cession de l'Alsace. Il effectue son premier voyage aux États-Unis en 1871.
Le 14 octobre 1875, le même jour qu'Alexandre Chatrian, il est initié dans la loge Alsace-Lorraine*, créée au mois de septembre 1872, le 9 décembre 1880 il passe au grade de compagnon* et de maître dans cette même loge. En 1876 il retourne aux États-Unis où il rencontre Jeanne-Émilie Baheux de Puysieux, protestante unitarienne qu'il épouse le 20 décembre 1876. à cette date, il est déjà un sculpteur reconnu et plusieurs de ses oeuvres ont été inaugures ta Paris, Colmar, Marseille, Bordeaux, Avallon. L'amour et la défense de la patrie inspirent bon nombre de ses sculptures: les statues du général Rapp (Colmar ), de Vauban (Avallon), de Vercingétorix {Clermont-Ferrand), le Lion de Belfort (Belfort et Paris), le monument à la mémoire des Français tombes en 1870-18771 (Schinznach} et le monument des Aéronautes de la guerre de 1870-1871 (Paris).... La statue de la Liberté, offerte aux États-Unis par la France grâce aux bons offices de l'Union franco-américaine, suscite l'intérêt de la franc-maçonnerie; la première pierre du monument (5 tonnes...') est posée le 5 août 1884 et la statue est inaugurée le 26 octobre 1886. Une réplique est offerte à la ville de Poitiers «par souscription sur l'initiative des loges maçonniques du département de la Vienne » Le 12 novembre 1891, la loge Alsace-Lorraine organise une tenue* Solennelle aprés l'inauguration du monument élevé à Sèvres à la mémoire de Gambetta*, dont la réalisation à été confiée à Bartholdi; l'orateur présente l'oeuvre du sculpteur. Celui-ci meurt le 5 octobre 1904.
J. L.
BASSON
Instrument de l'harmonie, le basson fut dignement représente en maçonnerie par des artistes de renom. On peut citer François René] Gebauer {17731845} qui travailla à l' Opéra, à la Chapelle de l'empereur et t à l'Académie royale de musique. Il fut également professeur au Conservatoire de 1795 à 1802, puis de 1824 à 1838 ll appartint à la loge* des Sept Écossais en 1829-1831 et participa à une cérémonie funèbre du Grand Orient* en 1832.
Louis Marie Eugéne Jancourt (1815-1901), professeur de basson au Conservatoire, soliste de I' Opéra-Comique, fut frère de l'harmonie des Frères Unis Inséparables*, initié en 1842, maître* en 1846 et Rose-Croix* en 1849. Il reste fidèle à sa loge jusqu'en 1866 (il est inscrit dans l'AImanach de M. Pinon),? participe à de nombreuses cérémonies maçonniques (dont le concert de t bienfaisance du Grand Orient en 1845 et la 1Oe fête des Prix de vertu, organisée par Isis-Mortyon en 1852). Son implication dans les activités musicales de sa loge correspond à un goût prononce pour les associations et sociétés musicales: en 1842, il intégra la Société des concerts du Conservatoire et, en 1843, il contribua à la fondation de I'Association des artistes musiciens (à laquelle il resta fidèle jusqu en 1879).
BATTERIE
Signal sonore d'une seule note dont la cadence constitue une « phrase musicale », la batterie est utilisée par les principaux officiers*, à l'aide du maillet, ou par l'ensemble des frères qui tapent dans les mains, soit pour ouvrir et fermer les travaux de loge, soit pour recevoir les visiteurs. Dans le premier cas on indique par des coups réguliers le grade* auquel on travaille et, dans le second, il est de coutume de s'annoncer par des coups particuliers.
Malgré ce « tronc commun », les batteries diffèrent dans les pratiques selon les rites* et les grades, ces différences ayant pour fondement les nombreuses combinatoires possibles en fonction du nombre de coups et du choix opéré entre la régularité des coups ou l'existence d'un rythme donnée à ceux-ci. Ainsi, le Rite Émulation* le Rite Ecossais Ancien et Accepté*, le Rite Français* et le Rite Écossais Rectifié* ne présentent pas les mêmes types de batterie. Les trois premiers rites optent pour des coups rythmes, mais le nombre de ceux-ci varie ('3 à chaque grade pour le premier; 3, 5 et 9 coups pour le deuxième, et 3, 6 et 9 pour le dernier). Si cette répartition (:3. 6, 9) prévaut également au Rite Ecossais Ancien et Accepté, le rythme voulu pour celui-ci est en revanche régulier.
A ce rite, comme au Rite Français, on pratique aussi des batteries spécifiques. comme les batteries de deuil et d'allégresse lors du décès d'un frère. La première suit la minute de silence de rigueur et est suivie immédiatement de la seconde qui symbolise la vie.
Comme souvent en maçonnerie, cette pratique soulève des questions pour lesquelles les réponses restent hypothétiques. Celle des origines est de celles-ci: les uns défendant le. postulat de l'héritage des forgerons habitués à la pratique des coups, mais d'autres préféreront évoquer le savoir des tailleurs de pierre chassant le trait ou ciselant la pierre. Quant à l' explication du rythme ou de la régularité des coups, si l'origine des coups rythmés reste obscure, les rites pratiquant la régularité font nettement référence aux Anciens*, notamment aux trois grands coups qui marquent la demande du profane pour entrer dans le temple et à ceux qui marquent la fin de l'initiation* (The Tree Distinct Knocks, 1760} . Quelles que
soient les filiations exactes, on doit signaler que les deux genres existent de manière synchronique dés le début du siècle l'abbé Pérau les mentionnant dans Le Secret des francs-maçons des 1742
E.S.
BAYLOT
, Jean (Pau, 1897-Paris, 1976) . Issu d'une famille d'artisans béarnais Jean Baylot naît le 27 mai 1897 d'Alexis lot, tailleur, et de Marguerite Taffy. Il fait des études au collège de l'lmmaculée-conception, puis à l'École Supérieure bois à Paris. Surnuméraire aux P.T.T. à Bordeaux (1915) puis engagé volontaire (septembre lD17-novembre 1918), le jeune Jean est nommé commis au bureau de la rue Saint-Roch en juin 1919 et participe aussitôt à la vie syndicale. En 1920, il est gérant du Syndiculisme des P.T.T., périodique du syndicat national des agents des P.T.T. Opposé à la C.G.T.U., Baylot demeure au sein de la «veille » C.G.T. En janvier 1923, il accède commission à la exécutive de l'Union départementale de la Seine et devient, au cours de la même année, secretaire général de la Fédération postale C.G.T. En 1930, il rompt avec cette dernière, mais figurera néanmoins parmi les quatorze syndicalistes arrêtés lors de la manifestation des fonctionnaires le 18 décembre 1933.
Le 19 mai 1928, il épouse à Paris Marie Madeleine Lechanteur. Leur fille, Jacqueline Baylot (11 mai 1927-27 mars 1967) se maniera à Claude Jean Charbonniaud futur préfet, futur président de la Chambre régionale des comptes de Provence Alpes-Côte d'Azur et Grand Maître de la Grande Loge Nationale Française* à partir de 1994
Dans la décennie 1930, Baylot continue sa carrière au sein des P.T.T. comme rédacteur principal, inspecteur, puis chef de division à la direction des recherches et du contrôle technique.
Il reçoit, entre 1921 et 1923, les trois degrés maçonniques dans la loge parisienne La Fraternité des Peuples (Grand Orient de France*) et s'affilie en 1929 aux Amis de l'Humanité. En septembre 1938 il est conseiller de l'Ordre. Secrétaire dudit Conseil durant la «drôle de guerre », Baylot assure l'évacuation d'une partie des archives de l'obédience vers Bordeaux. Mais surtout, à partir du printemps 1941, il devient l'un des principaux animateurs de la Résistance* maçonnique.
En mars I944, il est nomme préfet des Basses-Pyrénées et prend ses fonctions en julliet. Le 4 janvier 1946, il est nommé préfet de Haute-Garonne et officiellement intégré dans le corps préfecture à compter du 22 août 1944. En juin 1947, Baylot est nomme secrétaire général à la présidence du Conseil dirigé par Paul Ramadier*. Il sera ensuite préfet des Bouches du-Rhone {février 1948), puis préfet de police (avril 1951). Mêlé à diverses affaires, Baylot fut placé hors cadre en octobre 1955.
Partisan de l'Algérie française, rallié au général de Gaulle aprés quelques hésitations, Baylot fait campagne pour le oui au référendum de 1958. Il est alors élu député « indépendant » de la Seine (XVe arrondissement de Paris) jusqu'en novembre 1962, et devient vice-président du Cercle Républicain (1960).
Durant ces années, réélu deux fois au Conseil de l'Ordre, Baylot est également cofondateur des loges Rectitude (Marseille) et Europe unie {Paris). Sa rupture avec le Grand Orient date de 1958 lorsque, avec une partie de sa loge, il quitte l'obédience de la rue Cadet pour la Grande Loge Nationale Française dite « Bineau ». Devenu Grand Maître Provincial de Guyenne, il cofonde plusieurs ateliers, notamment la loge de recherches n° 81 Villard de Honnecourt (1966). Il exerce également la charge de Grand Prieur des Gaules.
Écrivain fécond, il est l'auteur de nombreux articles et ouvrages, notamment te Dossier français de la franc-maçonnerie reguliére (Paris, L'Horizon International 1965), La Voie substituée . recherche sur la déviation de la franc-maçonnerie en France et en Europe (préface de Marius Lepage, Liège, Borp, 1968; nouvelle édition, Paris, Dervy, 1985}, Le Complot des sergents de La Rochelle (Tours, Mame 1969) La Franc-Maçonnerie traditionnelle {Paris, Vitiano, 1972} Oswald Wirth (1860- 1943), rénovateur et mainteneur de la véritable franc-maçonnerie (Paris Dervy, 19759.
Baylot meurt à Paris le 3 février 1976. Grand collectionneur, il légua à la Bibliothèque nationale près de 2 500 ouvrages, documents et pièces maçonniques. La mise en vente publique de 649 lots, les 30 juin et 1er juillet 1984, fut l'une des plus
importantes ventes Françaises d'objets maçonniques
Y. H.M.
BEAUHARNAIS
 ,Marie Joséphe Rose dite Joséphine de (Trois-Ilets, Martinique, 23 juin 1763-Malmaison, 29 mai 1814) Marie Joséphe Rose dite Joséphine Tascher de La Pagerie est issue d'une famille créole de la Martinique. Elle épouse à Noisy-le-Grand, le 13 décembre 1779, un officier - Alexandre de Beauharnais. Celui-ci est membre, ainsi que son frère aîné François, marquis de Beauharnais, des loges* Sainte-Sophie et La Fidélité. Joséphine fut vraisemblablement initiée à Strasbourg, lorsque le général de Beauharnais tenait garnison à l'armée du Rhin. Dans sa correspondance, récemrnent publiée, de nombreuses lettres, toutes datées du Consulat, tendent à confirmer cette appartenance. Joséphine prend l'habitude, suivant l'identité de son destinataire, d'ajouter un signe maçonnique: il s'agit de deux ou trois barres parallèles ou bien de trois points disposés soit en ligne, soit en triangle, soit entre deux barres. Dans une lettre du 17 janvier 1782, adressée à Bacon de la Chevalerie*, elle lui écrit: «Cher Frère ». Sous l'Empire, c'est d'ailleurs en ces termes qu'elle écrit encore au « Très Illustre Frère » Cambacéres*.
,Marie Joséphe Rose dite Joséphine de (Trois-Ilets, Martinique, 23 juin 1763-Malmaison, 29 mai 1814) Marie Joséphe Rose dite Joséphine Tascher de La Pagerie est issue d'une famille créole de la Martinique. Elle épouse à Noisy-le-Grand, le 13 décembre 1779, un officier - Alexandre de Beauharnais. Celui-ci est membre, ainsi que son frère aîné François, marquis de Beauharnais, des loges* Sainte-Sophie et La Fidélité. Joséphine fut vraisemblablement initiée à Strasbourg, lorsque le général de Beauharnais tenait garnison à l'armée du Rhin. Dans sa correspondance, récemrnent publiée, de nombreuses lettres, toutes datées du Consulat, tendent à confirmer cette appartenance. Joséphine prend l'habitude, suivant l'identité de son destinataire, d'ajouter un signe maçonnique: il s'agit de deux ou trois barres parallèles ou bien de trois points disposés soit en ligne, soit en triangle, soit entre deux barres. Dans une lettre du 17 janvier 1782, adressée à Bacon de la Chevalerie*, elle lui écrit: «Cher Frère ». Sous l'Empire, c'est d'ailleurs en ces termes qu'elle écrit encore au « Très Illustre Frère » Cambacéres*.
Un fils, Eugéne, est venu au monde en 1781, puis, en 1783, une fille, Hortense. Elle se sépare en 1783 de son mari, puis devient veuve en 1794 après l'exécution de son époux pendant la Terreur. Elle devient une des égéries du Directoire et la maîtresse de Barras. Elle rencontre alors Bonaparte* qui la nomme Joséphine. à la consternation du clan Bonaparte, le jeune général l'epouse, le 9 mars 1796. Couronnée impératrice le 2 décembre 1804, elle joue son rôle dans la prise de contrôle de la maçonnerie par le régime. après avoir assiste à Strasbourg à une tenue* mixte, le 15 septembre 1805, Joséphine s'emploie, en effet, avec plus ou moins de succès, à raviver la maçonnerie d'adoption* dont elle est la Grande Maîtresse, ainsi que de l'atelier Sainte-Caroline, dont le vénérable* d'honneur était son beau-frère Murat*. Son divorce avec l'empereur est prononcé le 15 décembre 1809; elle conserve toutefois son titre d'« impératrice reine couronnée».
Son fils fut également un maçon de qualité: vénérable d'honneur de la loge Saint-Eugéne qui à pris pour titre distinctif son prénom, il devient grand maître du Grand Orient d'ltalie* et Souverain Grand Commandeur du Suprême Conseil d'ltalie .
P.-Fr. P.
BEDARRIDES
: voir RITES ÉGYPTIENS
BEGEMANN
Wilhelm (Bückeburg 1843-1914) Philologue, docteur en philosophie, maître de conférences à l'Academie des langues vivantes de Berlin (1872-1876), directeur d'école à Rostock (1876-1895), puis à Charlottenburg. Begemann est l'un des meilleurs historiens allemands de la franc-maçonnerie. Initie le 1er février 1879 à Rostock, dans la loge Irene zu den drei Sternen, Tempel der Wahrheit, und Prometheus (Grosse Landesloge von Deutschland}, il occupe les fonctions de Grand Maître Provincial du Mecklembourg, de 1888 à 1895.
Runkel à souligne, en la déplorant, I' inflexible volonté de Begemann de ne rien Acceptér de l'histoire de la franc-maçonnerie qui ne soit atteste par un document Cette approche amène en 1888 la Grosse Landesloge à abandonner la légende templiére défendue par Adolf Widrnann' (1818-1878). Avec Henry Sadler, Begemann est l'un des 23 maçons qui, en février 1887, demandent à devenir membres du Cercle de correspondance de la loge de recherches Quatuor Coronati*, fonde deux mois plus tôt. Dans un article e publie dans le premier volume (1888) d'Ars Quatuor Coronatorum (AQC), il est le premier à établir une classification des , Old Charches* qu i fait toujours autorité, expliquant avoir collationne toutes les versions qui en étaient alors connues. Entre 1891 et I9O8, il publie 9 articles dans AQC, mais il ne deviendra jamais membre actif de la loge Quatuor Coronati.
Begemann est l auteur de nombreux articles parus dans la Zirkelkorrespondenz, organe trimestriel puis mensuel de son obédience*, et d'essais tels que Die Tempelherren und die Freimaurer ( Le Temple des hommes et la Franc-Maçonnene ) en 1906, Der Alte und Angenommene Schottische Ritus und Friedrich der Grosse (« Le Rite Ecossais Ancien et Accepté et Frederic le Grand ») et Von Hund's Masonic Career {« La Carrière maçonnique de von Hund »} en 1913. Entre ,1909 et 1914, il publie quatre ouvrages consacres aux débuts de la franc-maçonnerie en Angleterre (2 vol., 1909-1910),
en Irlande* (1911), en Ecosse* (1914}.
Avant de publier ce dernier livre qui aurait dû comporter deux volumes et que la mort l'empêche d'achever, il va consulter sur place les archives des loges* écossaises.
Aucune de ses oeuvres ne fit jamais l'objet d'une recension dans AQC au moment de sa sortie. En janvier I9l4, le rapport annuel de la loge annonce une traduction anglaise, effectuée par Lionel Vibert, des deux volumes consacres a I'Angleterre. Elle ne sera jamais publiée.
Dans un long article inclus dans le volume 54 (1943) d'AQC, Knoop et Jones ont effectue un survol prétendument administratif de l'oeuvre de Begemann, ou transparaît néanmoins une jalousie freudienne inexprimée.
A. B.
BELGlQUE
 En 1814, avec la chute du Premier Empire*, les 35 loges recensées dans les anciens Pays-Bas autrichiens* intégrés pendant une décennie dans le Grand Empire* sont transférées vers la souveraineté hollandaise (Pays-Bas*}. Sur le plan maçonnique, les obstacles à une bonne entente entre la partie nord et partie sud du pays apparaissent rapidement car les différences linguistiques ne facilitent pas l'harmonie dans les échanges... de même que les dissensions politiques et économiques qui vont à court terme entraîner la division en 1830. Elles se répercutent à l'intérieur des temples*. Les divergences sont accrues par les divisions liées aux hauts grades*. Alors que le Rite Ecossais Ancien et Accepté se répand rapidement dans les provinces belges depuis Bruxelles, en Hollande, suite à la volonté du prince Frédéric, on ne pratique que le Rite Français* en sept degrés. Pour envenimer les choses, les tensions internes sont importantes. En Belgique existent deux Suprêmes Conseils du Rite Ecossais Ancien et Accepté. Le premier, celui qui survivra, est fonde par le général français Royer et à reçu une patente du Suprême Conseil de France alors que le second est fonde par des militaires au service de la Hollande, le duc de Saxe Weimar et le général belge Daine qui ont reçu une patente du comte de Grasse-Tilly*.
En 1814, avec la chute du Premier Empire*, les 35 loges recensées dans les anciens Pays-Bas autrichiens* intégrés pendant une décennie dans le Grand Empire* sont transférées vers la souveraineté hollandaise (Pays-Bas*}. Sur le plan maçonnique, les obstacles à une bonne entente entre la partie nord et partie sud du pays apparaissent rapidement car les différences linguistiques ne facilitent pas l'harmonie dans les échanges... de même que les dissensions politiques et économiques qui vont à court terme entraîner la division en 1830. Elles se répercutent à l'intérieur des temples*. Les divergences sont accrues par les divisions liées aux hauts grades*. Alors que le Rite Ecossais Ancien et Accepté se répand rapidement dans les provinces belges depuis Bruxelles, en Hollande, suite à la volonté du prince Frédéric, on ne pratique que le Rite Français* en sept degrés. Pour envenimer les choses, les tensions internes sont importantes. En Belgique existent deux Suprêmes Conseils du Rite Ecossais Ancien et Accepté. Le premier, celui qui survivra, est fonde par le général français Royer et à reçu une patente du Suprême Conseil de France alors que le second est fonde par des militaires au service de la Hollande, le duc de Saxe Weimar et le général belge Daine qui ont reçu une patente du comte de Grasse-Tilly*.
La révolution de, 1830 consacre la séparation des deux États, et, en Belgique, un régime politique libéral conduit par Leopold 1er (1790-1865). Ce pays est dote d'une Constitution qui garantit les libertés, ce qui place la maçonnerie dans une situation à priori plus favorable. Le roi Leopold 1er à d'ailleurs été initie en 1813 en prive, dans la loge Hoffnung de Zurich à un moment ou le jeune officier général servait dans les armées du tsar de Russie* Alexandre. Néanmoins, même s'il est bien en relations avec le Premier Grand Surveillant du Grand Orient de Belgique Joseph Defrenne, à la tête de l'Ordre en attendant la nomination d'un Grand Maître, Leopold n'a jamais eu à aucun moment une activité réelle en tant que francmaçon. La maçonnerie belge reste donc divisée et le Grand Orient de Belgique débute en 1833 avec un petit noyau d'une dizaine de loges*. 10 loges ont cesse leurs activistes après 1830 et 5 autres se sont placées sous l'obédience* du Grand Orient des Pays-Bas. De plus, le Grand Orient de Belgique ne désigne un Grand Maître qu'en mai 1835, date à laquelle le baron de Stassart, sénateur et gouverneur du Brabant, est installe dans cette haute charge probablement à l'incitation du roi. à partir de décembre 1837, bien que l'article 135 des statuts du Grand Orient de Belgique de 1833 I'interdise, la francmaçonnerie belge se politise car le Saint-Siège lance un mandement violemment anti maçonnique lu au prône dans toutes les églises du royaume. Il impose l'exclusion des francs-maçons de l'Église en les privant de tous Tes sacrements s'ils n'abjurent pas l'Ordre* dans des circonstances hurniliantes. La franc-maçonnerie belge, qui à déjà mis à son actif la création de l'université libre de Bruxelles, réagit et devient alors le moteur de la création du Parti libéral qui va activement combattre la politique catholique. La politisation se traduit par l'abandon, en 1854, de l'article 135 et ouvre la voie à « l'action politique Acceptée» de la franc-maçonnerie. En outre, en 1868-1870, lors de la révision de la Constitution, le Grand Orient de Belgique approuve la suppression de la référence au Grand Architecte de l'Univers* par toutes ses loges. Dés lors le recrutement des francs-maçons belges se fait uniquement dans la bourgeoisie libérale anticléricale.
Les élections de 1884* qui voient le triomphe du Parti catholique et l'nstauration d'une majorité catholique amenée à gouverner le pays jusqu'en 1918, conduisent les loges à accentuer leur anticléricalisme. Dans les procès-verbaux de la loge Les Amis Philanthropes, on trouve ainsi des interventions répétées d'un membre en faveur de l'organisation de cours d'anticléricalisme! Puis, de l'anticléricalisme on glisse vers l'irréligion, certaines loges refusant les honneurs maçonniques funèbres à des défunts de religion juive ou, protestante. De son côte, le parti catholique brandit activement I étendard de L'antimaçonnisme*. Selon lui, la franc-maçonnerie « vole I âme des enfants dans des écoles sans Dieu». La déclaration le 15mai 1878, de Woeste (1837-1922) à la Chambre des représentants témoigne parfaitement de son opposition à la maçonnerie mais, malgré l'existence de cet ennemi redoutable, la franc-maçonnerie belge reste divisée. Dans ce contexte la croissance et le rayonnement sont faibles: il y à 22 loges à partir de 1909 et la dernière inscrite, L'Ére Nouvelle, mène d'ailleurs une existence précaire au Congo belge, tandis que les liens maçonniques internationaux personnels se limitent aux pays limitrophes, la France la Hollande et l'Allemagne. Sur le plan des réussites, on peut cependant citer l'excellence des relations entre les Suprêmes Conseils de Belgique et de France:« Le traité d'amitié et d'alliance entre le Gr.. Or.. et le Sup.. Cons.. de Belgique,» à en effet été signe le 23 août 1880 et les deux parties ont reconnu comme seules autorités en Belgique, le Grand Orient de Belgique pour les trois premiers grades symboliques et le Suprême Conseil du Belgique pour tous les degrés du 4° au 32°. De plus, les relations avec la Grande Loge Unie d'Angleterre* existent sous forme « d' échanges de correspondance entre Grands Secrétaires», ce qui veut dire que les visites réciproques ducs francs-maçons sont autorisées et que chaque année les Grands Secrétaires font part à leur a/ter ego du tableau des Grands Officiers et des listes des loges.
Pourtant, à l'aube de la Grande Guerre une crise éclate avec Londres. En effet. en 1909, le Colonial Committee s' aperçoit que la Belgique ne répond plus depuis 1872 aux critères de régularité*, car toutes les références au Grand Architecte de l'Univers ont été supprimées. On le retire de la liste des obédiences.

Après la guerre, une part de l'action «des loges maçonniques belges est canalisée vers le rétablissement des relations avec la Grande Loge Unie d'Angleterre. Quelques pionniers, dont J. Debruges, et G. Smets-Mondez, vont tenter entre 1920 et 1960 de promouvoir une ouverture vers les obédiences « régulières» Il est vrai que, lors de la guerre de 1914-1918, les franc maçons belges réfugiés en Angleterre ont pu expérimenter les incidences fâcheuses de I isolement. Ils n'ont en effet pas eu accès aux tenues* et aux locaux de la Grande Loge Unie d'Angleterre. Ceux qui sont membres du Suprême Conseil de Belgique sont admis comme visiteurs dans les organes du Suprême Conseil d'Angleterre, car cette obédience composée de maçons membres de la Grande Loge Unie d'Angleterre est indépendante de celle-ci et peut donc entretenir des relations actives avec son homologue belge. En 1926 le Bulletin du Grand Orient de Belgique publie un long rapport de J. Debruge de Liège où il examines les possibilités de rétablir des relations formelles avec les Grandes Loges étrangères Il y examine les causes et les moyens à rnettre en oeuvre pour rétablir des relations avec la franc-maçonnerie anglo-saxonne et, en conclusion, affirme que le rétablissement dans toutes les loges des symboles, de l'invocation au Grand Architecte de l'Univers et de la présence du volume de la Loi sacrée (Bible) sur l'autel est indispensable au rétablissement de ces relations.
Mais le printemps 1940 arrive trop tôt pour cela. La franc-maçonnerie est interdite. Toutefois dans ce pays qui est sous juridiction militaire et non civile, la lutte anti-maçonnique est essentiellement le fait des collaborateurs. Les francs-maçons ne sont pas poursuivis systématiquement, mais lorsque juifs* ou résistants sont arrêtés l'affiliation à la franc-maçonnerie aggrave leur sort Henri Story à Gand ou Maxime Van Praag à Bruxelles). Aprés la guirre, les rares collaborateurs sont exclus et hommage est rendu à ceux qui ont disparu dans la lutte pour la patrie, notamment à ceux qui ont tenu une loge clandestine comme ce fut le cas dans le camp de concentration d'Esterwegen en Allemagne.
Sur plan maçonnique, les années 1950 voient les intentions énoncées par les partisans de la poursuite du resserrement des relations avec la Grande Loge Unie d'Angleterre avant 1939 se concrétiser.En effet, en 1955, lorsque cinq Grandes Loges {le Grand Orient des Pays-Bas, la Grande Loge suisse Alpina*, Ia Grande Loge de Luxembourg, la Grande Loge de Vienne pour l'Autriche et la Grande Loge Unie pour l'Allemagne*) se réunissent à Luxembourg pour signer une convention destinée à conduire à l'harmonisation des relations entre toutes les Grandes Loges européennes le texte de cette convention étant vraisemblablement inspiré par les déclarations anglaises Aims and Relationship of the Craft, le Grand Orient de Belgique est invité à participer aux discussions à Bruxelles et à Paris. Elles échouent en 1959, car ce dernier reste fidèle à ses principes et adopte une attitude très claire. Des le début des discussions, il ne peut accepter l'obligation de la présence en loge ouverte du volume de la Loi sacrée, de l'Équerre* et du Compas sur l'autel, ainsi que l'invocation au Grand Architecte de l'Univers tant pour les tenues du Grand Orient que pour les loges.
Cependant, il n'intervient pas lorsque certaines loges rétablissent ces pratiques, ce qui est le cas pour la majorité de ses propres loges. Face à cette contradiction cinq loges belges (Le Septentrion de Gand Mamix-van-St.-Aldegonde d'Anvers, La Constance de Louvain, La Parfaite Intelligence et L'Étoile Réunie de Liège et Tradition et Solidarité de Bruxelles), en décembre 1959, quittent le Grand Orient de Belgique pour créer une deuxième obédience maçonnique: la Grande Loge de Belgique. Cinq ans plus tard, cette entité obtient la reconnaissance* de la Grande Loge Unie d'Angleterre. C'est une situation nouvelle après 130 ans d'unité maçonnique au sein du Grand Orient de Belgique et ,elle n'est pas sans susciter des conflits. à la Grande Loge de Belgique, des divergences profondes apparaissent après 1975 au sujet du maintien des relations avec le Grand Orient de Belgique. Elles entraînent en juin 1979 une rupture de; relations avec la Grande Loge Unie d'Angleterre et une partie des loges font sécession pour créer la Grande Loge Reguliére de Belgique. Elle est promptement reconnue par la Grande Loge Unie d'Angleterre et l'ensemble des autres obédiences mondiales... qui rompent avec la Grande Loge de Belgique.
Il en résulte surtout la situation paradoxale de voir un petit pays comptant quelques milliers de francs-maçons partagé entre plusieurs obédiences. De plus, il existe une fédération belge du Droit Humain* depuis le 28 avril 1928 dont la loge la plus ancienne (Égalité Émile-Lefévre n° 45) à vu le jour le 22 février 1911 sous les auspices de la loge Les Amis Philanthropes au début du siècle et entretient d'excellentes relations avec le Grand Orient de Belgique et la Grande Loge de Belgique. Enfin, depuis le 17 octobre 1981, il existe, issue de la Grande Loge Féminine de France*, une Grande Loge Féminine de Belgique, née de la création de quatre loges féminines entre 1674 et 1979 (Irini, 1974; La Source et L'Étoile Mosane, 1976; L'Épr, 1979). Les divisions des obédiences ont cependant entraîne une prolifération de loges - le Grand Orient de Belgique en compte plus d'une centaine, la Grande Loge de Belgique environ 40 et la Grande Loge Reguliére de Belgique 37 à la mi-juin 9999. L'accroissement des effectifs s'accompagne d'une démocratisation du recrutement et de la création de nouvelles loges dans des petites villes. Comme les obédiences qui coiffent les trois premiers grades, les obédiences qui gouvernent les hauts grades* ont connu un éclatement des structures. Si, après la partition du début du XIXe siècle, une fusion est intervenue rapidement donnant naissance au Suprême Conseil de Belgique qui est jusqu'en 1960 la seule autorité des hauts grades dans ce pays, il n'existe aujourd'hui pas moins de six Suprêmes Conseils ou équivalents sans compter les organes régulateurs de degrés auparavant non pratiqués dans le pays tels l'Arche royale, la Maçonnerie de Marque*, le Régime Écossais Rectifié*...
M. B.
BELLO
Andres {Caracass 1781-Chili 1865} Le lien présume entre Andres Bello et la franc-maçonnerie semble un mythe contemporain cultive par des hagiographes qui prétendent attribuer une affiliation maçonnique à toutes les figures importantes ayant marqué l'histoire de l'émancipation de I Amérique latine (Empire espagnol*).
D'aprés plusieurs de ses biographes l'éminent philologue, poète, essayiste historien et juriste fut initié à la «loge,» des Caballeros raciona/es (Chevaliers de la Raison), à Londres en 1811. Il y serait entré accompagné de Luis Lopez Mendez et de Bolivar*, à la suite de la mission que leur avait confiée la Junte gouvernementale de Caracas. Ces assertions semblent douteuses, car Bello était alors le plus modéré des délègues que la Junte avait envoyés pour entreprendre des démarches auprès du gouvernement britannique. En effet, parmi les trois, les deux hommes d'action étaient Bolivar et Lopez Mendez. Bolivar fut celui qui assimila Ie plus rapidement l'idéologie indépendantiste et radicale sous l'égide de Miranda et Lopez Mendez passa son temps à nouer des relations diplomatiques en vue de l'indépendance. De son côte, Andrés Bello fut le plus réticent à l'accepter et il lui fallut quelques mois pour surmonter ses scrupules moraux, le déroulement des événements le poussant à acceptér celle-ci comme une solution irrémédiable. à partir de la seulement, sa collaboration avec la société de Miranda devint effective.
D'autre part, l'organisation des Caballeros racionales, dite aussi Gran Reunion Americana*, n'est pas à proprement parler une loge maçonnique. Son lien supposé avet la maçonnerie tient aux assertions de Bartolomé Mitre (1821-1906), président argentin qui concevait l'organisation patriotique fondée à Londres par Miranda comme une société maçonnique. Or, ce c'était pas une loge ni sur le plan de la légitimité maçonnique ni selon la tradition à laquelle se rattachent les sociétés franc-maçonnes. Fixé dans la capitale britannique, Bello se charge en 1822 du secrétariat de la légation du Chili à Londres et. trois ans plus tard, de celui de la légation de Colombie. Il conserve ce poste jusqu'en 1827. À Londres, il publie de nombreux essais, des articles de presse et la revue El repertorio americano (Le Répertoire américain). Enfin, en 1829, il s'installe où Chili il réside jusqu'a sa mort, en 1865. C'est s ce pays qu'il publie la plus grande partie de son oeuvre, faisant preuve d'une énorme capacité de création en éditant des ouvrages de droit. Il rédige également son célèbre Précis de grammoire castillane qui est un apport fondamental pour l'étude de la langue espagnole.
M. de P. S.
BÉDÉDICTINS
 Le succès de la franc maçonnerie parmi les Bénédictins doit être restitué dans le contexte d'une franc maçonnerie 'Ancien Régime exerçant une forte attraction sur le clergé*. C'est surtout à partir de la fondation du Grand Orient*, en 1774, que l'on observe le succès de la sociabilité maçonnique chez les Bénédictins, notamment parmi les membres de la congrégation de Saint-Maur. En Normandie, où sont implantées quatre des plus grandes abbayes bénédictines (Le Bec-Hellouin, Saint-Wandrille, Jumiéges et la Sainte-Trinité à Fécamp), plus de 40 mauristes figurent ainsi parmi les clercs initiés dans cette province entre 1774 et 1789. Les mauristes sont d'ailleurs à l'iniliative de la naissance de trois loges don't ils constituent le vivier de recrutement (La Triple Unité à Fécamp, Les Amis la Vertu à Bernay el L'Union Cauchoise à Caudebec-en Caux). En Lorraine, la loge de Bouzonville constituée en mars 1789, Les Frères Amis Réunis, est également composée majoritairement de Bénédictins (vannistes).
Le succès de la franc maçonnerie parmi les Bénédictins doit être restitué dans le contexte d'une franc maçonnerie 'Ancien Régime exerçant une forte attraction sur le clergé*. C'est surtout à partir de la fondation du Grand Orient*, en 1774, que l'on observe le succès de la sociabilité maçonnique chez les Bénédictins, notamment parmi les membres de la congrégation de Saint-Maur. En Normandie, où sont implantées quatre des plus grandes abbayes bénédictines (Le Bec-Hellouin, Saint-Wandrille, Jumiéges et la Sainte-Trinité à Fécamp), plus de 40 mauristes figurent ainsi parmi les clercs initiés dans cette province entre 1774 et 1789. Les mauristes sont d'ailleurs à l'iniliative de la naissance de trois loges don't ils constituent le vivier de recrutement (La Triple Unité à Fécamp, Les Amis la Vertu à Bernay el L'Union Cauchoise à Caudebec-en Caux). En Lorraine, la loge de Bouzonville constituée en mars 1789, Les Frères Amis Réunis, est également composée majoritairement de Bénédictins (vannistes).
On peut expliquer ce phénomène par la conjonction de deux faits. D' u ne part, le mode de diffusion de la franc-maçonnerie est fonde sur des facteurs de « proximité professionnelle et culturelle » correspondant au genre de vie monacal. D' autre part, il faut lire l'initiation des Bénédictins de Saint-Maur comme le témoignage de la crise spirituelle et institutionnelle qui touche la congrégation au XVIIIe siècle entre la publication de la bulle Unigenitus (1713} condamnant le jansénisme* et la réforme institutionnelle de 1781. La réforme met fin à la pratique de la perpétuation du supérieur et institue le principe de l'élection à cette fonction importante pour une durée de six ans. Elle ne fait pas l'unanimité et amplifie la crise spirituel]e ouverte par les retombées de la condamnation du jansénisme. Le mouvement avait, en effet, fortement pénètre les abbayes bénédictines et cela explique pourquoi les Bénédictins furent si nombreux à fréquenter les loges. Comme pour l'ensemble du clergé, la Révolution* mit pratiquement fin à ce phénomène d'agrégation massive des Bénédictins aux loges maçonniques.
E. S.
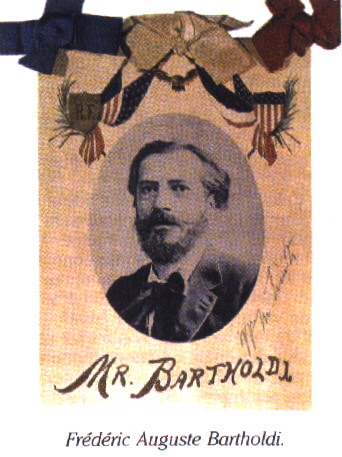 Frederic Auguste (Colmar, 1834-Paris, 1904) Bartholdi est né dans une famille protestante, dont la présence est attestée en Allemagne et en Alsace d es le XVIIe siècle e. Son père , Jean Charles Bartholdi, conseiller de préfecture, étant décédé en 1836, sa mère, née Charlotte Beysser, vient s'installer à Paris avec Auguste et son frère aîné Charles. Auguste Bartholdi fait ses études au lycée Louis-le Grand, qu'il abandonne souvent pour les ateliers d'Etex, de Soitoux, d'Ary Scheffer. Un récit veut qu'il ait été témoin de l'insurrection contre le coup d'état du 2 décembre 1851 et qu'il ait assisté au spectacle d'une jeune fille tenant une torche à la main et poussant les hommes au combat avant de s'écrouler sous les balles. Cette image lui aurait inspiré son oeuvre la plus célèbre, la statue de la Liberté, dont l'idée première incomberait à Edouard Laboulaye. Il expose pour la première fois au Salon de 1853 ou il présente un groupe intitule Un bon Samaritain. En 1856, il voyage en Égypte. Garde national, il laisse de nombreux croquis de la guerre franco-prussienne, durant laquelle il séjourne à Tours et à Bordeaux; comme tous les Alsaciens, il est éprouvé parla défaite et la cession de l'Alsace. Il effectue son premier voyage aux États-Unis en 1871.
Frederic Auguste (Colmar, 1834-Paris, 1904) Bartholdi est né dans une famille protestante, dont la présence est attestée en Allemagne et en Alsace d es le XVIIe siècle e. Son père , Jean Charles Bartholdi, conseiller de préfecture, étant décédé en 1836, sa mère, née Charlotte Beysser, vient s'installer à Paris avec Auguste et son frère aîné Charles. Auguste Bartholdi fait ses études au lycée Louis-le Grand, qu'il abandonne souvent pour les ateliers d'Etex, de Soitoux, d'Ary Scheffer. Un récit veut qu'il ait été témoin de l'insurrection contre le coup d'état du 2 décembre 1851 et qu'il ait assisté au spectacle d'une jeune fille tenant une torche à la main et poussant les hommes au combat avant de s'écrouler sous les balles. Cette image lui aurait inspiré son oeuvre la plus célèbre, la statue de la Liberté, dont l'idée première incomberait à Edouard Laboulaye. Il expose pour la première fois au Salon de 1853 ou il présente un groupe intitule Un bon Samaritain. En 1856, il voyage en Égypte. Garde national, il laisse de nombreux croquis de la guerre franco-prussienne, durant laquelle il séjourne à Tours et à Bordeaux; comme tous les Alsaciens, il est éprouvé parla défaite et la cession de l'Alsace. Il effectue son premier voyage aux États-Unis en 1871.
 ,Marie Joséphe Rose dite Joséphine de (Trois-Ilets, Martinique, 23 juin 1763-Malmaison, 29 mai 1814) Marie Joséphe Rose dite Joséphine Tascher de La Pagerie est issue d'une famille créole de la Martinique. Elle épouse à Noisy-le-Grand, le 13 décembre 1779, un officier - Alexandre de Beauharnais. Celui-ci est membre, ainsi que son frère aîné François, marquis de Beauharnais, des loges* Sainte-Sophie et La Fidélité. Joséphine fut vraisemblablement initiée à Strasbourg, lorsque le général de Beauharnais tenait garnison à l'armée du Rhin. Dans sa correspondance, récemrnent publiée, de nombreuses lettres, toutes datées du Consulat, tendent à confirmer cette appartenance. Joséphine prend l'habitude, suivant l'identité de son destinataire, d'ajouter un signe maçonnique: il s'agit de deux ou trois barres parallèles ou bien de trois points disposés soit en ligne, soit en triangle, soit entre deux barres. Dans une lettre du 17 janvier 1782, adressée à Bacon de la Chevalerie*, elle lui écrit: «Cher Frère ». Sous l'Empire, c'est d'ailleurs en ces termes qu'elle écrit encore au « Très Illustre Frère » Cambacéres*.
,Marie Joséphe Rose dite Joséphine de (Trois-Ilets, Martinique, 23 juin 1763-Malmaison, 29 mai 1814) Marie Joséphe Rose dite Joséphine Tascher de La Pagerie est issue d'une famille créole de la Martinique. Elle épouse à Noisy-le-Grand, le 13 décembre 1779, un officier - Alexandre de Beauharnais. Celui-ci est membre, ainsi que son frère aîné François, marquis de Beauharnais, des loges* Sainte-Sophie et La Fidélité. Joséphine fut vraisemblablement initiée à Strasbourg, lorsque le général de Beauharnais tenait garnison à l'armée du Rhin. Dans sa correspondance, récemrnent publiée, de nombreuses lettres, toutes datées du Consulat, tendent à confirmer cette appartenance. Joséphine prend l'habitude, suivant l'identité de son destinataire, d'ajouter un signe maçonnique: il s'agit de deux ou trois barres parallèles ou bien de trois points disposés soit en ligne, soit en triangle, soit entre deux barres. Dans une lettre du 17 janvier 1782, adressée à Bacon de la Chevalerie*, elle lui écrit: «Cher Frère ». Sous l'Empire, c'est d'ailleurs en ces termes qu'elle écrit encore au « Très Illustre Frère » Cambacéres*.
 En 1814, avec la chute du Premier Empire*, les 35 loges recensées dans les anciens Pays-Bas autrichiens* intégrés pendant une décennie dans le Grand Empire* sont transférées vers la souveraineté hollandaise (Pays-Bas*}. Sur le plan maçonnique, les obstacles à une bonne entente entre la partie nord et partie sud du pays apparaissent rapidement car les différences linguistiques ne facilitent pas l'harmonie dans les échanges... de même que les dissensions politiques et économiques qui vont à court terme entraîner la division en 1830. Elles se répercutent à l'intérieur des temples*. Les divergences sont accrues par les divisions liées aux hauts grades*. Alors que le Rite Ecossais Ancien et Accepté se répand rapidement dans les provinces belges depuis Bruxelles, en Hollande, suite à la volonté du prince Frédéric, on ne pratique que le Rite Français* en sept degrés. Pour envenimer les choses, les tensions internes sont importantes. En Belgique existent deux Suprêmes Conseils du Rite Ecossais Ancien et Accepté. Le premier, celui qui survivra, est fonde par le général français Royer et à reçu une patente du Suprême Conseil de France alors que le second est fonde par des militaires au service de la Hollande, le duc de Saxe Weimar et le général belge Daine qui ont reçu une patente du comte de Grasse-Tilly*.
En 1814, avec la chute du Premier Empire*, les 35 loges recensées dans les anciens Pays-Bas autrichiens* intégrés pendant une décennie dans le Grand Empire* sont transférées vers la souveraineté hollandaise (Pays-Bas*}. Sur le plan maçonnique, les obstacles à une bonne entente entre la partie nord et partie sud du pays apparaissent rapidement car les différences linguistiques ne facilitent pas l'harmonie dans les échanges... de même que les dissensions politiques et économiques qui vont à court terme entraîner la division en 1830. Elles se répercutent à l'intérieur des temples*. Les divergences sont accrues par les divisions liées aux hauts grades*. Alors que le Rite Ecossais Ancien et Accepté se répand rapidement dans les provinces belges depuis Bruxelles, en Hollande, suite à la volonté du prince Frédéric, on ne pratique que le Rite Français* en sept degrés. Pour envenimer les choses, les tensions internes sont importantes. En Belgique existent deux Suprêmes Conseils du Rite Ecossais Ancien et Accepté. Le premier, celui qui survivra, est fonde par le général français Royer et à reçu une patente du Suprême Conseil de France alors que le second est fonde par des militaires au service de la Hollande, le duc de Saxe Weimar et le général belge Daine qui ont reçu une patente du comte de Grasse-Tilly*.

 Le succès de la franc maçonnerie parmi les Bénédictins doit être restitué dans le contexte d'une franc maçonnerie 'Ancien Régime exerçant une forte attraction sur le clergé*. C'est surtout à partir de la fondation du Grand Orient*, en 1774, que l'on observe le succès de la sociabilité maçonnique chez les Bénédictins, notamment parmi les membres de la congrégation de Saint-Maur. En Normandie, où sont implantées quatre des plus grandes abbayes bénédictines (Le Bec-Hellouin, Saint-Wandrille, Jumiéges et la Sainte-Trinité à Fécamp), plus de 40 mauristes figurent ainsi parmi les clercs initiés dans cette province entre 1774 et 1789. Les mauristes sont d'ailleurs à l'iniliative de la naissance de trois loges don't ils constituent le vivier de recrutement (La Triple Unité à Fécamp, Les Amis la Vertu à Bernay el L'Union Cauchoise à Caudebec-en Caux). En Lorraine, la loge de Bouzonville constituée en mars 1789, Les Frères Amis Réunis, est également composée majoritairement de Bénédictins (vannistes).
Le succès de la franc maçonnerie parmi les Bénédictins doit être restitué dans le contexte d'une franc maçonnerie 'Ancien Régime exerçant une forte attraction sur le clergé*. C'est surtout à partir de la fondation du Grand Orient*, en 1774, que l'on observe le succès de la sociabilité maçonnique chez les Bénédictins, notamment parmi les membres de la congrégation de Saint-Maur. En Normandie, où sont implantées quatre des plus grandes abbayes bénédictines (Le Bec-Hellouin, Saint-Wandrille, Jumiéges et la Sainte-Trinité à Fécamp), plus de 40 mauristes figurent ainsi parmi les clercs initiés dans cette province entre 1774 et 1789. Les mauristes sont d'ailleurs à l'iniliative de la naissance de trois loges don't ils constituent le vivier de recrutement (La Triple Unité à Fécamp, Les Amis la Vertu à Bernay el L'Union Cauchoise à Caudebec-en Caux). En Lorraine, la loge de Bouzonville constituée en mars 1789, Les Frères Amis Réunis, est également composée majoritairement de Bénédictins (vannistes).